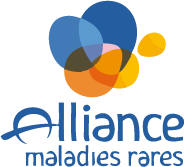Françoise : ma vie a basculé
Mon histoire avec la CI a commencé de manière brutale un soir de septembre 2001, par de violentes douleurs dans le bas-ventre dont je n'étais pas coutumière, n'ayant jamais eu d'antécédents de règles douloureuses, de cystites bactériennes ou autres désagréments féminins. Les douleurs étaient suffisamment vives pour que j'appelle un médecin en urgence qui, après auscultation et perplexité (les ovaires peut-être ?), me prescrit une échographie que je fis dès le lendemain. L'examen s'avéra catastrophique : j'avais bu comme on me l'avait demandé, autant que je pouvais, mais peu avant l'examen j'avais si mal que je demandai à aller aux toilettes ; échographie ou pas, je ne pouvais plus me retenir. Une fois aux toilettes, impossible d'uriner, blocage quasi total, je dus m'y reprendre à trois fois avant d'arriver à un piètre résultat ; sur ce l'échographie fut pratiquée : normale, sauf qu'on y constatait un globe vésical. On m'envoya me faire sonder dans le service voisin d'urologie et une fois soulagée, je fus prise en consultation par l'urologue. Une fois assise devant lui, ce monsieur me regarda un moment sans rien dire puis finit par déclarer : « ce que vous avez n'arrive pas aux femmes ».
Ce défaut d'explication m'aurait probablement suffi si l'accident n'avait pas eu de suite et si la situation s'était améliorée, mais bien sûr ce ne fut pas le cas. Une pollakyurie insistante s'était désormais installée et je me vis bientôt obligée de consulter de nouveau. Mon généraliste m'adressa à un urologue exerçant dans une clinique privée non loin de mon domicile, qui s'employa dès lors à envisager tous les cas possibles : cystite bactérienne d'abord, bien que les analyses aient été négatives, partant du principe que mes symptômes ne s'expliquaient normalement que dans un contexte infectieux. Le traitement antibiotique, associé au bleu de méthylène (pour soulager l'inflammation, je crois), n'eut cependant aucun succès : je fis des pipis bleus pendant trois semaines, mais ils étaient toujours aussi fréquents. Mon médecin passa alors la vitesse supérieure : béta-bloquants (urion) pour faciliter la miction, et instillations vésicales à base de nitrate d'argent, espérant que la muqueuse vésicale ainsi décapée se régénèrerait. Le traitement était pénible, les injections douloureuses, surtout le passage de la sonde dans un urètre rétréci. Dans un premier temps cela parut améliorer les choses ; mais si l'inflammation de la vessie avait semblé régresser, les douleurs persistaient au niveau de l'urètre.
Mes problèmes avaient bien sûr été remarqués par mes collègues de travail qui me voyaient désormais fréquenter assidûment certains endroits. J'en plaisantais, j'avais dit à mes collègues les plus proches que j'avais des problèmes de prostate (c'était d'ailleurs l'unique indication de l'urion, que je continuais à prendre quotidiennement) ; certains m'avaient gentiment proposé de redécorer les WC du service, vu le temps que j'y passais, en faisant des toilettes à thème : toilettes zen (décoration japonaise), toilettes océan (décoration algues, filets et coquillages), etc… Mais je commençais à fuir les réunions, les séances de formation, et je me rendais compte que j'avais tout juste le temps de me rendre à mon travail en faisant pipi juste avant de partir et aussitôt arrivée (1 heure de trajet par les transports en commun).
Le nitrate d'argent n'ayant pas marché, mon urologue tenta la chirurgie : dilatation de l'urètre (qui était très rétréci), électro-coagulation des zones inflammées de la vessie, sans plus de succès, mais la cytoscopie avait révélé une zone ecchymotique bien particulière et la biopsie pratiquée en même temps avait permis d'éliminer un certain nombre de causes possibles, en particulier le cancer. J'en étais à 6 mois de galère à faire pipi toutes les 90 mn nuit comprise. A ce moment là, mon urologue m'annonça prudemment que, par élimination de tout le reste, il concluait à une cystite interstitielle, et me donna une documentation pour m'informer, en soulignant le fait que dans beaucoup de cas la CI évolue peu et reste à un stade léger, ce qui n'apparaissait pas clairement dans la documentation en question. Il tenta dès lors des traitements plus spécifiques de la CI : injections vésicales de corticoïdes, hydrodistention vésicale sous anesthésie, le tout sans amélioration durable.
Assez rapidement, des douleurs permanentes s'étaient installées, rendaient difficiles marche et station debout, et rigoureusement impossibles la course à pied et la pratique de différents sports.
A ce stade, ma vie quotidienne était assez radicalement bouleversée : plus de sorties, plus d'invitations chez des amis, plus de sport ; accompagner mes enfants à l'école, faire mes courses, la moindre activité devenait un défi à relever. J'ai commencé à acheter mes vêtements par correspondance, je me suis procuré un tabouret de bar pour pouvoir faire ma cuisine et ma vaisselle assise. Je faisais à vélo le moindre trajet, plus question de marcher. Prendre les transports en commun pour me rendre à mon travail devenait chaque jour une entreprise plus risquée. Obligée plus d'une fois de descendre de la rame pour me trouver des toilettes en catastrophe, il me fallait m'expliquer auprès des commerçants ou des agents de la RATP : au début, en prise à la douleur, j'avais du mal à trouver mes mots, j'étais secouée de convulsions ; je voyais au regard des gens à qui je m'adressais qu'ils me prenaient pour une droguée et ils ne m'aidaient pas toujours. Par la suite, mieux préparée, j'ai appris à m'expliquer de manière simple et cohérente, et il était rare que je n'obtienne pas une aide immédiate.
Le manque de sommeil dû aux cycles trop courts (un heure au maximum) se faisait cruellement sentir dans la journée : vertiges, pertes d'équilibre, fatigue, trous de mémoire. Par la suite, mon corps s'est adapté je pense, et ces symptômes ont régressé au bout de 6 mois environ.
Je savais à quoi m'en tenir désormais sur la CI. Je m'étais documentée sur internet et je ne me faisais guère d'illusions. En même temps, je refusais de me rendre à l'évidence et d'une certaine manière d'accepter la maladie en la laissant dominer mon quotidien, mes activités, me priver de tout ce que j'aimais. La colère l'emportait en moi sur le découragement contre cette maladie qui m'atteignait autant dans mon genre de vie et me rognait les ailes. La pire des privations était la perte d'autonomie et de capacité de déplacement. J'ai toujours été un pigeon voyageur : ne plus pouvoir partir aurait été une petite mort pour moi. Avec une bonne dose d'inconscience, je suis partie en Libye en octobre 2002, un an après le début de la maladie. Je crois que je connais l'emplacement de tous les WC de Tripoli. Je faisais feu de tout bois : les halls des grands hôtels où je pénétrais discrètement, les petits cafés de la médina. Je prenais la dose maximum de di-antalvic et de spasfon pour pouvoir marcher (aucun médecin n'avait encore songé à me prescrire des dérivés d'opium !). C'était en général très insuffisant. Je me souviens qu'un soir, les deux amis qui m'accompagnaient ont dû me faire la « chaise à porteurs » avec leurs mains pour me permettre de parcourir les dernières dizaines de mètres qui nous séparaient de la maison de l'ami chez qui nous allions dîner tous trois. La plupart du temps, je prenais les petits taxis collectifs qui parcourent la ville en tous sens et s'arrêtent à la demande. Le vaste périmètre de la magnifique ville romaine de Septis Magna est heureusement envahi par la nature et les buissons ; plus d'un m'a servi. Comment sortir de Tripoli ? Il était hors de question que je prenne le bus de nuit qui va de Tripoli à la ville berbère de Benghazi, près de la frontière tunisienne. J'ai dû renoncer à aller visiter ce joyau. De même, les peintures rupestres du Fezzan, au cœur du désert, étaient trop loin. A à la place, je suis partie en taxi collectif pour les montagnes plus proches du Djebel Nefoussa, en plein pays berbère. Le taxi était vieux et mal entretenu et consommait beaucoup d'essence : les arrêts à la pompe furent suffisamment nombreux pour que, tout le temps du trajet, je puisse trouver tous les WC qu'il fallait. Seul un pneu crevé faillit me mettre dans l'embarras : le temps de changer la roue, il m'avait fallu trouver un buisson d'urgence, heureusement il faisait nuit.
A mon retour de Tripoli j'avais conscience d'avoir exigé beaucoup de ma bonne étoile. La fréquence augmentant, les trajets pour aller à mon travail étaient devenus très problématiques. Je n'arrivais même plus souvent à atteindre le premier WC public existant sur mon trajet. Je me résignai à utiliser les serviettes pour incontinence. Le premier essai, assise chez moi dans la salle de bain, fut un fiasco complet. Je m'obstinai et arrivai à un meilleur résultat en restant debout, avec un bel effort de volonté. Petit à petit, j'arrivai à utiliser les serviettes en public. Pour me donner une contenance, je me plaçai devant un plan de métro ou une quelconque affichette pendant les quelques minutes nécessaires à déclencher la miction. A présent , avec plusieurs mois d'entraînement, je suis capable de les utiliser dans à peu près toutes les situations, y compris en voiture en conduisant. La maîtrise de la serviette pour incontinence a été le sésame pour une (relative) liberté retrouvée. Suivant la taille, je peux tabler sur une, voire deux heures d'autonomie de vol garantie. Il n'est pas toujours possible de les utiliser ; en particulier, lorsque la douleur est trop vive, la miction dans ces conditions devient impossible. Il faut donc les utiliser à temps, et hors période de crise.
La sédentarisation, la cessation de toute pratique sportive, la suppression d'un grand nombre de nutriments dans mon alimentation (viande rouge…) avaient provoqué une petite perte de poids et surtout une importante fonte musculaire. Les rares jours où j'allais mieux et où je reprenais une activité normale, je me rendais compte que j'étais rapidement essoufflée, que j'avais rapidement mal au dos ou mal aux muscles. J'ai essayé de continuer à aller à la piscine mais ce n'était pas facile car l'eau froide augmente l'envie d'uriner ; les sorties à la piscine se terminaient en général par des sorties de bain toutes les 5 minutes et les trajets de retour étaient toujours extrêmement problématiques. J'ai adopté le vélo d'appartement, seul sport qui ne me pose pas de problème. Les abdominaux en salle me provoquent souvent des douleurs à la vessie, je pense par pression. Je me suis acheté des rollers… plus par défi que par réel espoir de les utiliser, en tout cas de façon régulière.
En 2003, je suis tombée enceinte. J'avais envie de pouponner de nouveau et en même temps avoir un bébé était un défi à la maladie. Je m'étais bien renseignée et je savais que dans deux cas sur trois, la grossesse apporte même une rémission. J'étais donc optimiste. En réalité, je devais faire partie du tiers restant, celui pour lequel la grossesse aggrave les choses au contraire : mictions quasi doublées (j'en étais à plus de 40 par jour, une quinzaine par nuits) et surtout douleurs bien plus fortes, à la limite parfois du tolérable. En même temps, la grossesse limitait le champ des médicaments que je pouvais prendre. Mais j'étais moralement remontée à bloc, prête à en découdre jusqu'au bout, prête à me battre pour mon bébé. Peut-être n'ai-je pas su faire suffisamment de concessions à ma maladie. Malgré la douleur, j'ai continué à aller à mon travail, et lorsqu'il y a eu des grèves de transports en juin j'y suis allée comme d'habitude. Entre-temps, j'avais obtenu de la COTOREP une reconnaissance d'invalidité de 50% et une carte de station debout pénible qui m'assurait à peu près d'une place assise dans les transports, d'autant plus que je rusais en allant en vélo prendre la rame au terminus de la ligne. Mais un soir, à cause de manifestations devant l'Assemblée nationale, toutes les bouches de métro du secteur avaient été fermées. Je cherchai en vain un taxi : le boulevard St Germain d'un côté, les ponts de la Seine de l'autre étaient bouclés et aucun taxi ne pouvait passer. Je me résolus à marcher, penser pouvoir trouver un métro pas trop loin. Mais les ponts de la Seine étaient bouclés pour les piétons aussi et je dus marcher durant deux heures, à mon pas de petite mémé et en comptant les haltes-pipis dans les cafés, avant de trouver un métro ouvert. J'étais pliée de douleur. Une semaine plus tard, lors d'une échographie de contrôle, j'appris que le bébé n'était plus vivant. Son cœur avait cessé de battre probablement une semaine plus tôt – peut-être le jour même où j'avais eu si mal en rentrant chez moi. Hasard peut-être, fatalité en tout cas, mais j'en ai tiré une conclusion : il faut savoir parfois écouter son corps et ne pas refuser de céder devant la maladie. Depuis, j'ai accepté de me mettre en arrêt de travail lorsque les crises sont trop fortes et que de toute évidence je ne suis pas en état de tenir debout.
J'ai également renoncé à avoir un troisième enfant ; j'ai accepté le fait que je n'ai pas la capacité physique ni de le mettre au monde ni de m'en occuper ensuite. De ce fait, j'ai pu prendre des traitements qu'il ne m'était pas possible d'essayer tant que j'étais enceinte, en particulier le tagamet qui a peut-être légèrement amélioré les choses. Depuis que j'en prends en effet, il y a des jours où les douleurs sont légères, presque inexistantes, et je peux à ces moments là reprendre une activité quasi normale, marcher (pas courir certes !), jardiner, alors qu'auparavant les douleurs étaient permanentes (sauf les deux jours durant lesquels j'ai mes règles). Il y a donc un mieux, mais qui n'empêche pas les retours en arrière et les crises parfois sévères.
Pour essayer d'y voir clair, je tiens un journal où je note jour après jour l'intensité des douleurs selon une échelle de 1 à 4, ce que j'ai mangé de façon à pouvoir établir des corrélations entre certains aliments et l'apparition de certaines crises, et (pas tous les jours mais à intervalle réguliers) le nombre de mictions en 24 H en précisant le nombre de mictions nocturnes. Hier par exemple, j'ai relevé 35 mictions dont 15 nocturnes et l'intensité douloureuse était de 3 (douleurs importantes) : je suis allée travailler, mais j'ai pris du tramadol. Je note aussi tout ce qui peut avoir changé dans mon environnement ou dans les médicaments que je prends. Je suis devenue une adepte de la bouillotte et des coussins. J'ai adapté mes trajets de façon à marcher le moins possible : quitte à mettre plus de temps et à changer plusieurs fois, j'ai réduit au minimum la longueur des correspondances de métro. J'ai heureusement aussi pu adapter mes activités au travail : je passe un maximum de temps à rédiger sur mon ordinateur et je me déplace le moins possible. Je bois régulièrement, pour éviter de concentrer les urines, mais toujours très peu à la fois. Je n'ai jamais constaté aucune corrélation entre le stress et les crises bien que cela influe, je le sais, chez certaines. Les causes et les mécanismes de cette maladie sont bien obscurs et je me garderais bien d'avancer aucune hypothèse mais je suis sûre au moins d'une chose : ce n'est pas dans la tête et il est complètement inutile d'aller voir ni psychiatre ni psychologue, si ce n'est le cas échéant pour arriver à gérer mieux un quotidien rendu difficile par la maladie.
C'est une maladie dont j'ai honte, car elle touche un organe et une fonction intimes et dénués de noblesse. J'ai bien souvent du mal à en parler, encore aujourd'hui. Je mets mes difficultés à marcher, pour qui me le demande, sur le compte d'un mal de dos imaginaire. Je suis déconcertée par l'imprévisibilité des crises et la variabilité de mon état. Je déteste lire la pitié dans le regard de ceux qui savent que je suis malade. Il y a une question que je déteste, c'est « comment vas-tu ? » : je vais toujours bien. Le plus souvent je garde ma douleur pour moi, lorsque j'ai du mal à me déplacer dans les couloirs à mon travail j'essaye de me donner une contenance, je feins d'ouvrir une enveloppe et de lire un papier en marchant.
Je constate aussi que l'on s'habitue à la douleur (c'est devenu une seconde nature pour moi) et que le corps fait des merveilles pour compenser ses propres dysfonctionnements. Je souffre beaucoup moins qu'au début du manque de sommeil, preuve que mon corps s'est adapté à ne jamais dormir plus d'une demi-heure ou une heure d'affilée.
En même temps, l'expérience de la douleur permanente m'a donné un recul plus grand par rapport à tout ce qui pourrait m'arriver dans la vie et aux petites misères du quotidien, plus d'empathie et d'ouverture aux autres car je n'essaye plus de me protéger (à quoi bon ?), une rage de vivre plus grande aussi car chaque plaisir, chaque bon moment est chèrement acheté et a donc plus de prix. Elle m'a donné d'apprécier aussi l'amour de mon conjoint et de mes enfants et la grande solidarité qui peut exister entre malades frappés du même fléau. En ce sens, la maladie m'a apporté quelque chose : il faut bien que chaque malheur porte en lui aussi le germe de quelque chose de positif.


 Nous adhérons aux
Nous adhérons aux