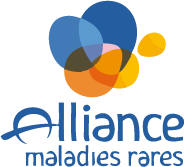Eva : une maladie difficile à faire reconnaître
Tout semble avoir commencé à la suite d'une intervention chirurgicale. En effet, en 1990 j'ai été opérée en urgence, et sous cœlioscopie, d'un kyste ovarien qui s'est avéré être endométriosique. Cette intervention s'est effectuée dans des conditions déplorables (en particulier au plan psychologique) et il m'a fallu plus d'un an pour me remettre des effets de l'anesthésie générale.
Ensuite, j'ai eu des mycoses et cystites bactériennes récidivantes auxquelles se sont ajoutées des crises d'hémorroïdes et une migraine chronique pendant deux ans de 1993 à 1995. Tout cela s'est atténué mais la partie n'était pas gagnée pour autant. Dès 1990, j'éprouvais une sensation de gêne dans la zone du méat urinaire vraisemblablement consécutive à une sonde urinaire qui provoquait un pincement désagréable. J'avais consulté un urologue qui n'avait décelé aucune anomalie. Pourtant peu à peu, je commençai à avoir des douleurs vésicales et vaginales. Elles se manifestaient par une sensation de pression permanente, de l'irritation, des brûlures, l'impression d'avoir un oursin ou un cactus dans le vagin. J'ai fait une quantité impressionnante de prélèvements et d'analyses voire une cystoscopie sans A.G. ! qui n'ont rien donné. Tous ces symptômes se sont aggravés au fil du temps, notamment depuis que j'ai été ménopausée en 1997 à 47 ans, et ont affecté ma vie privée, sociale et professionnelle. Les rapports sexuels sont devenus extrêmement douloureux. La pénétration déclenche automatiquement des brûlures. On dirait que j'ai des micro-fissures comme si l'on m'avait incisé les parois du vagin et qu'on y versait du sel et du vinaigre. Ce qui devrait être un plaisir se transforme en véritable cauchemar ! tant sur le coup que pendant les jours qui suivent. J'ai la chance d'avoir un mari attentif et compréhensif, mais l'image de soi-même en prend un sérieux coup et on a le sentiment de ne plus être une femme à part entière. De plus, je souffre d'un «syndrome pollakurie-impériosités » (pour reprendre les termes d'un urologue) invalidant. Cela signifie que je tiens rarement plus d'une heure en périodes normales et dix à vingt minutes en périodes de crises. Dans la journée, si je vais en ville pour faire les boutiques ou dans un parc pour sortir mon chien, je sais d'avance que la sortie sera gâchée par la quête éperdue de toilettes que je ne trouve pas toujours d'ailleurs (nous sommes en France ! disons au passage que l'Angleterre est un véritable paradis pour les patient(e)s atteint(e)s de CI), ce qui m'oblige à arrêter mes sorties pour me précipiter chez moi car la rétention des urines engendre des douleurs atroces. J'ajoute qu'habitant près du centre ville, je n'ai pas des kilomètres à parcourir, mais lorsque je suis dans une autre ville c'est une autre paire de manches !
Quant au sommeil, parlons-en !, il est haché par les réveils intempestifs dus aux impériosités. Ces derniers sont plus ou moins nombreux selon les périodes mais quelle qu'en soit la fréquence, il m'est souvent très difficile de me rendormir et les journées de travail débutent par une grande fatigue qui ne me permet pas d'être aussi performante que l'exige une activité professionnelle. Comme je suis enseignante en lycée, que j'ai pour mission de préparer des élèves au bac, que ma conscience professionnelle et mon perfectionnisme (hélas !) font de moi un bourreau du travail, que bien des élèves sont pénibles aujourd'hui, que l'on ne peut abandonner sa classe même si on meurt d'envie d'aller aux toilettes, et bien il arrive un moment où on craque. C'est ce qui s'est passé pour moi à la rentrée 2003 de retour d'un voyage an Angleterre (j'ai effectivement constaté que généralement les voyages ont des effets nocifs sur la C.I.). Je suis arrivée épuisée et l'époque, je me levais cinq à six fois chaque nuit. Alors au mois d'octobre, j'étais dans un tel état de surmenage que je me suis littéralement effondrée devant plusieurs collègues. Mon généraliste m'a mise dans un premier temps en arrêt-maladie et m'a prescrit des calmants et un anti-dépresseur qui n'ont en aucun cas été bénéfiques, bien au contraire puisque mon état de fatigue est vite devenu chronique. Je n'étais pas en mesure de reprendre et sur les conseils d'une collègue syndicaliste qui m'avait vue au plus bas, j'ai demandé un congé longue-maladie. Les comités médicaux mettant trois voire quatre mois à se réunir, et ayant fait appel d'une première décision négative, j'ai dû attendre presqu'une année dans l'angoisse et la culpabilité : la CI n'est pas connue des médecins eux-mêmes et encore moins du grand public. J'ai donc eu droit à des réflexions du style «Mais qu'est-ce que tu as au juste ?» «Elle est fatiguée, nous aussi on est fatigués, c'est trop facile !» etc… Au cours de mon arrêt, j'ai passé beaucoup de temps allongée, abrutie par les médicaments, j'avais de plus en plus de mal à trouver mes mots, j'avais la sensation d'être décérébrée.
J'ai décidé que cela ne pouvait plus durer et j'ai pris l'initiative d'aller consulter des urologues au C.H.U. (mon généraliste nie l'existence même de la CI - pourtant il est humain et très gentil avec moi - même s'il a fait une demande d'ALD qui depuis a été acceptée !). J'ai rencontré un premier professeur qui dès le départ a déclaré, sans aucun examen à l'appui, que mon état relevait de la gynécologie et il s'apprêtait à me renvoyer sans façon. J'ai insisté en lui disant qu'il représentait mon dernier espoir et que j'avais envie de me jeter par la fenêtre s'il ne faisait rien. Il m'a donc adressée à une consultante en urologie qui m'a demandé de surveiller mon alimentation et de faire un calendrier mictionnel en notant scrupuleusement la date, 1'heure et le volume des mictions ainsi que les crises douloureuses. A l'issue de cela sans tenir compte de la fréquence et de l'impériosité des mictions, elle a affirmé que ce qui comptait pour eux c'était la capacité de ma vessie car le volume fluctuait d'une fois sur l'autre, mais ça leur suffisait, peu importait les répercussions sur ma vie quotidienne alors que c'est dans ce but que j'avais rencontré cette dame. Un jour, pour lui décrire ce que je ressentais lorsque je suis contrainte de me retenir, je lui ai expliqué que c'était comme si ma vessie allait exploser. Alors elle a braqué sur moi un regard quelque peu ironique et condescendant comme si j'exagérais et m'a répondu : « Ne vous inquiétez pas, elle ne va pas exploser»! Finalement, elle m'a adressée à un confrère dans le même service. Deux consultations avec lui m'ont convaincue que ma démarche avait été vaine, il m'a proposé de m'injecter du botox dans la vessie tout en me prévenant que ledit organe pourrait rester momentanément paralysé et qu'en prime l'on me munirait d'une sonde. Le bonheur assuré ! J'en ai parlé à mon généraliste et à mon psy (car j'ai oublié de mentionner ce détail d'importance : comme il se pourrait que la cause de la maladie soit d'origine psychique, il faut aussi chercher dans ce secteur-là, alors je sonde les profondeurs de mon inconscient mais sans succès jusqu'à présent) qui ont fait la grimace et m'ont fortement incitée à refuser. Depuis lors, je n'ai pas remis les pieds à l'hôpital.
A la même époque, en 2004, j'avais consulté un autre urologue en ville. Ce dernier a beaucoup plus d'écoute que les précédents et m'a prise au sérieux, (j'ai remarqué que nombreux sont les médecins qui détestent qu'on leur parle d'Internet, car c'est là que j'ai découvert l'existence de la CI et les forums de femmes qui racontent leurs souffrances et leur parcours du combattant). Il m'a proposé « un nouvel examen endoscopique sous anesthésie permettant de vérifier certains critères spécifiques de la CI, de réaliser des biopsies et de pratiquer dans le même temps une hydrodistention vésicale qui pourra lui apporter un bénéfice et réaliser également un test thérapeutique ». Il ajoute qu'il serait intéressant de faire une «cœlioscopie pelvienne pour certifier l'absence d'une anomalie résiduelle post endométriosique».
Cela se passait en juin 2004 et j'ai repris le travail en novembre 2004. J'ai eu depuis environ une année une belle rémission en ce qui concerne les douleurs, mais pas en ce qui concerne les impériosités et les rapports sexuels devenus quasiment impossibles. Du coup, je ne suis retournée voir aucun urologue et je n'ai pris aucun médicament. Je dois avouer que depuis mes opérations (on ajoute à la précédente une G.E.U. en 1984, elle aussi en urgence), j'ai une peur bleue des anesthésies générales. Depuis que j'ai lu les témoignages de patientes qui ont vécu un véritable calvaire, ont enduré toutes sortes d'examens et de traitements, ont testé de nombreux médicaments qui, au lieu d'améliorer leur état, ont augmenté leurs douleurs, je redoute d'être manipulée. J'ai pris rendez-vous avec mon gynécologue pour refaire le point, car il est l'un des rares à accepter de faire des recherches sur Internet. Je lui ai parlé de l'association et de son combat pour faire reconnaître la maladie.
Je suis perplexe et me sens démunie face à l'agressivité de personnes soupçonneuses qui doutent de ma bonne foi. Je vais illustrer ce dernier point qui est d'une importance capitale pour moi puisque mes problèmes de santé ont des incidences sur ma vie professionnelle. En 2002 je crois, j'avais téléphoné au Rectorat pour informer le service des examens que j'avais des problèmes urologiques et qu'il était de plus en plus pénible pour moi de faire passer les oraux du bac. En effet, ces derniers débutent à 8h du matin. On a entre 12 et 14 candidats par jour à raison d'une demi-heure chacun ; il n'y a personne pour nous remplacer pour aller aux toilettes et nous sommes censés ne pas laisser les candidats seuls. En outre, lorsque je me lève plusieurs fois par nuit, je suis épuisée dès le matin et je suis souvent au bord du malaise. J'ai la tête qui tourne comme si j'étais en état d'ébriété, j'ai du mal à garder les yeux ouverts et à comprendre ce que disent les élèves (les oraux de Français sont particulièrement fatigants). La personne que j'ai eue au téléphone m'a dit qu'elle prenait note et qu'elle mettrait cette information dans mon dossier. Or, cette année j'ai été convoquée officiellement pour les oraux et placée en position de réserve pour l'écrit. Je me suis donc rendue au service des examens pour expliquer, en vain à la chef de service qu'il serait préférable dans mon cas de corriger l'écrit (je suis à la maison donc à proximité des toilettes) quitte à avoir plus de copies que les autres, plutôt que de subir le calvaire des oraux. Je suis malheureusement tombée sur une personne des plus rigides qui a dû croire que je voulais me la couler douce et qui a refusé d'entendre parler de mes problèmes. Elle m'a suggéré de me mettre en maladie plutôt que d'accepter de transformer ma convocation d'oral en convocation d'écrit. Eh oui ! les gens bornés ça existe.
Comment faire pour être crue ? J'ai été contrainte pendant mon arrêt de parler de mon problème au proviseur pour obtenir un aménagement de mon emploi du temps. Mais comme j'ai eu une rémission depuis ma reprise de travail et que la maladie est très capricieuse, je redoute que les profanes et l'administration en particulier ne considèrent que j'affabule. Or je souhaiterais pour les années à venir être dispensée des oraux et n'être assujettie qu'à la correction des copies. Pour cela, il me faut aller voir le médecin-conseil du Recteur ou l'assistante sociale, mais me croiront-ils s'ils n'ont jamais entendu parler de la CI.? Je précise que c'est depuis l'année 2001 que les oraux sont devenus un calvaire pour moi, que j'ai 55ans, qu'il me reste un peu plus de 5 ans avant la retraite et que j'aimerais voir ma fin de carrière adoucie au moins en matière de santé.
La rédaction de ce récit a été longue et pénible. Je suis heureuse et soulagée qu'une association se mobilise pour lutter contre cette maladie rare. Je salue le mérite de ses membres et espère que mon témoignage puisse servir à d'autres personnes.



 Nous adhérons aux
Nous adhérons aux